Non. Je ne le pense pas. « L’enquête » du journal Le Devoir fait le buzz, mais ce n’est pas un scoop. Un scoop rend publics des secrets bien gardés dont la révélation peut avoir des conséquences durables (pour le meilleur ou pour le pire). Ici, on n’apprend rien de nouveau. Les artistes qui peinent à vivre du fruit de leur travail, des créateurs exploités jusqu’au dernier p’tit change, le manque de transparence, les subventions qui arrosent les jardins de l’industrie musicale, and what not. Tout ça, on le sait depuis belle lurette. Peut-être que madame et monsieur Tout-le-Monde — les personnes qui ne sont pas du milieu — sont surpris de lire que ça ne tourne pas rond au royaume des troubadours, quoi que j’en doute, mais pour ce qui est du cercle des professionnels de la profession, rien de neuf sous les nuages.
J’ai mis des guillemets au terme enquête car l’article du Devoir — Une douzaine d’artistes dénoncent les pratiques du groupe Ad Litteram — n’est pas une recherche systématique de la vérité par l’interrogation de témoins et la réunion d’éléments d’information. Les confidences d’une douzaine d’artistes qui ont du mal à se faire payer, la réputation entachée des uns et de mauvais payeur de l’autre, la colère affichée et certainement justifiée, des chiffres « pas clairs », et j’en passe… Ce qui manque surtout à cette « enquête », ce sont les éléments d’information justes, documentés, sourcés, vérifiés et surtout compris par les enquêteurs qui livrent la marchandise à leur rédacteur en chef et aux lecteurs du Devoir.
À la toute fin de l’article, une petite encartée sur fond gris pâle pose la question — Qui gère les redevances musicales ? — et propose des réponses. Pour la énième fois, je vais corriger le devoir, non pas le journal mais la copie d’un hypothétique étudiant, tel un prof désespéré, en fin d’année scolaire, de réaliser que son cours n’a vraisemblablement pas été efficace. Pour ceux qui le souhaitent, j’ai aussi rédigé une encartée qui explique plus en détail l’origine des revenus réels (hors subventions) de l’industrie de la musique. Que nos journalistes ne le prennent pas mal, comme une attaque personnelle — c’est compliqué, je l’admets. Ma seule critique, c’est que votre enquête n’en est pas une, et c’est juste mon opinion personnelle.

Revenons à nos moutons noirs : les boss de maisons de production de disques et de spectacles-éditeurs-gérants qui ne paient pas leurs factures et les redevances à leurs artistes. Évidemment, mon cœur penche du côté des créateurs, mais s’il existe des coupables dans notre industrie — des arrogants, des sans-gêne, de mauvais administrateurs, des gens malhonnêtes — il y a aussi de belles équipes qui travaillent fort et accompagnent du mieux possible leurs artistes, sereinement, dans tous leurs projets. La vraie responsable du déclin de notre industrie, et possiblement d’Ad Litteram, un label parmi d’autres en difficulté, c’est la non-rentabilité avérée de notre industrie. Son manque d’autonomie commerciale, sa dépendance aux subventions institutionnelles, la toute petite taille de son marché, la dévalorisation des supports et des transports de contenus. En gros, le trouble vient d’un système très fragile, sous perfusion, écrasé par la pression gigantesque d’une concurrence toutes disciplines confondues des moyens de divertissement disponibles plus ou moins gratuitement aujourd’hui. Ce n’était pas mieux avant, c’était moins. Il y avait moins d’offre.
Dans un second article du Devoir, paru quelques heures après « l’enquête » — Le milieu artistique réagit aux allégations concernant Ad Litteram — nos journalistes reviennent sur l’affaire, et il est beaucoup question de subventions et des montants versés au label mis en cause. La SODEC et MUSICACTION réagissent.
La SODEC indique qu’en 2024-2025, elle a octroyé 260 000 $ en subventions au groupe Ad Litteram par le biais de divers programmes, mais précise ne pas avoir reçu de plainte à ce jour. Dans la foulée des allégations de manque de transparence et de factures impayées contre le label, « la SODEC fera les vérifications nécessaires, selon les modalités de ses programmes, particulièrement dans le cas où la dépense admissible incluait le paiement d’une rémunération à des artistes », a fait savoir la directrice des communications de l’organisme, Johanne Morissette. De son côté, la Fondation Musicaction, qui a subventionné le groupe Ad Litteram à hauteur de plus de 600 000 $ en 2023-2024, a déclaré prendre « très au sérieux les allégations portées à sa connaissance. Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité du programme, en ayant à cœur le développement de la carrière des artistes ». L’organisme refuse toutefois de commenter de façon spécifique le dossier d’Ad Litteram.
Entre nous, ce n’est à priori pas la job de la SODEC ou de MUSICACTION de vérifier les comptes des entreprises qu’ils financent, ni de s’assurer que les créateurs bénéficient de ces financements. Ces organismes créent des tonnes de programmes destinés aux entreprises ; pour en bénéficier, il faut cocher toutes les cases avant de toucher l’argent et non après, sauf erreur de ma part.
Ces réactions de la SODEC et de MUSICACTION me rappellent une scène du film Testament de Denys Arcand où la ministre explique à la directrice d’une maison de retraite que le gouvernement n’aime pas voir au téléjournal des manifestants devant son établissement. On imagine que la SODEC et MUSICACTION (qui dépend de PATRIMOINE CANADA), n’ont pas apprécié d’être citées dans Le Devoir la semaine dernière dans un papier sur l’affaire Ad Litteram !
Les montants des subventions accordés à cette entreprise, mentionnés dans le texte, sont certainement approximatifs. Je ne vais pas les commenter. Le seul chiffre exact que je peux communiquer ici est 429. C’est le nombre de pages cumulées des rapports annuels de gestion de la SODEC, de MUSICACTION et du CALQ (n’oublions pas le CALQ). Ces documents sont publics et disponibles : ICI, ICI et LÀ. Bonne lecture ! Tout y est, ou presque. Quand je dis presque, c’est que les programmes dits « globaux » dont bénéficient les entreprises n’entrent pas trop dans le détail.
Le modèle d’affaires de l’industrie de la musique au Québec est un modèle subventionné. Il faudrait décortiquer ces rapports pour savoir combien notre industrie québécoise coûte à l’État. Il serait aussi intéressant de connaître quelle est en moyenne la part subventionnée du chiffre d’affaires des entreprises bénéficiaires. Là, nous pourrions parler d’une « enquête ». Serait-ce utile de la mener ? Oui, je pense. Ces organismes ont été créés il y a des décennies, autant dire dans un contexte qui n’est plus d’actualité. On les a rafistolés sans rien approfondir. Les entrepreneurs — qui, pour certains, sont impliqués dans la création des programmes d’aide dont ils bénéficient — maîtrisent peut-être avec un peu trop d’assurance le système. L’audience d’un marché « national » autosuffisant des trente glorieuses 70-80-90 s’est désintégrée. Oui. Un sérieux travail d’audit des lieux et des enjeux serait nécessaire. Le gouvernement ne va pas tirer la plug du jour au lendemain, mais année après année, petites coupes par petites coupes, l’écosystème va se réduire à peau de chagrin. Les catalogues d’œuvres vont être vendus aux plus offrants, au bénéfice de ceux qui auront mis la main dessus dès le départ. Et puis viendra le temps où plus personne ne voudra crever de faim pour la bonne cause de la culture. On aura des jobs de jour et on fera de la musique pour le fun, le soir, la nuit et les fins de semaine.
Encadré publié dans l’article 1 de l’affaire Ad Litteram
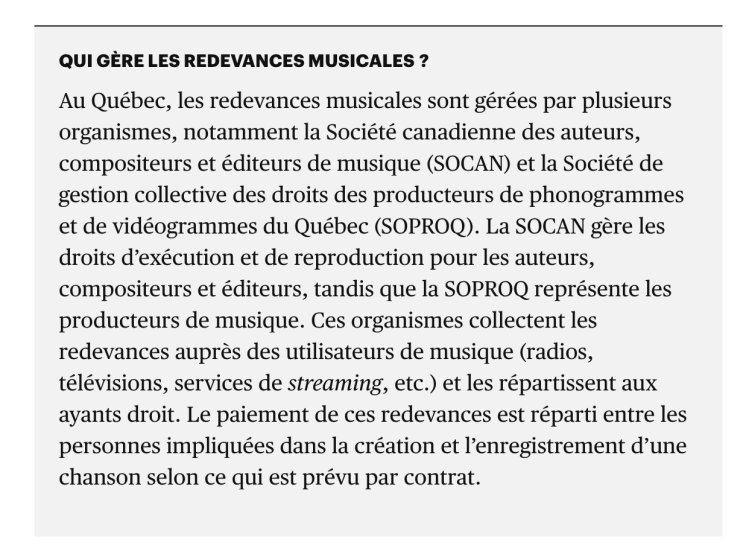
Commentaires sur les revenus cités et plus…
1. SOCAN – Cette société de gestion collective, dont sont membres et propriétaires les créateurs et les éditeurs, collecte effectivement auprès des radios, TV, salles de spectacles et de cinéma, plateformes numériques… des redevances qu’elle redistribue aux ayants droit : morts ou vivants, actifs ou passifs, créateurs ou entrepreneurs. Car oui, les producteurs de musique sont très souvent aussi éditeurs. Un créateur peut soit céder la part éditoriale de ses droits à son label et/ou éditeur, soit lui en confier l’administration. La SOCAN rappelle dans l’article 2 du Devoir qu’elle ne fait pas l’arbitre entre ses membres. Je confirme, c’est du vécu. Comme nous sommes tous membres au Canada, sauf les ayants-droits qui ont choisi d’expatrier leurs catalogues à l’étranger, ce qui est possible, la règle c’est : entendez-vous entre vous et quand vous aurez réglé le conflit, dites-nous combien, à qui on paye quoi.
2. SOPROQ – La SOPROQ peut représenter les droits voisins des producteurs ; je dis peut car leur service n’est ni obligatoire ni exclusif. Ces droits voisins ne représentent qu’une part des droits générés par la diffusion (l’utilisation) des enregistrements des chansons.
Qu’est-ce que le « droit voisin du droit d’auteur » ? Beaucoup plus récent que le concept du droit d’auteur, le droit voisin vient rectifier une certaine injustice qui, avant les années 80/90, ignorait la contribution artistique des producteurs et des interprètes (musiciens inclus). Dans les faits, avant cette pratique, les « diffuseurs » ne versaient des redevances qu’aux créateurs et éditeurs des chansons via les sociétés de gestion collective comme la SOCAN. Depuis, les producteurs et les interprètes touchent aussi un droit dit voisin du droit d’auteur.
Quelles sont les plus grandes sources de revenus des sociétés qui collectent les droits voisins pour leurs membres ? Cela dépend des pays. En Europe, une bonne partie de ces droits provient de la copie privée. Tous les appareils pouvant « stocker » du contenu — tels que les téléphones portables, ordinateurs, disques durs, clés USB — sont « taxés » afin de rémunérer les ayants droit des contenus en question. Bien sûr, personne ne vient vérifier le contenu de nos appareils ; on utilise un système de prorata pour définir les parts à reverser. C’est extrêmement complexe. Au Canada, la copie privée est pratiquement inexistante. La plus grande source de redevances liées aux droits voisins, et de très loin, provient des États-Unis. Plus exactement de SIRIUS XM. La SOPROQ collecte les droits versés par SIRIUS XM à SoundExchange pour la diffusion de la musique sur son réseau de « radios satellite ». Lire mon article sur le sujet ICI pour creuser un peu plus. By the way, beaucoup d’artistes sont producteurs ou coproducteurs de leurs enregistrements et touchent donc ces droits en tant que producteurs.
3. ARTISTI – Non évoquée dans l’enquête du Devoir, au Québec, ARTISTI fait le même travail que la SOPROQ, mais pour les artistes interprètes et musiciens. Lire ce qui précède en remplaçant le mot PRODUCTEUR par ARTISTE. Sans entrer dans trop de détails : la part des droits voisins qui revient aux artistes est de 50 %, si l’on inclut la cut de la Guilde des musiciens.
4. DISTRIBUTEURS – Non évoqués dans l’enquête du Devoir, les revenus du streaming, toutes plateformes confondues, sont collectés par les distributeurs de contenus numériques : Majors, Believe Digital, IDOL, pour ne citer qu’eux, sans oublier les entreprises qui offrent des services de distribution low cost par abonnement aux artistes « non signés » : DistroKid, TuneCore (propriété de Believe Digital), CD Baby, et beaucoup d’autres.
Extrait de l’article 1 du Devoir concernant le dépôt des œuvres

Commentaires un peu techniques
Le problème soulevé par Catherine Major — à savoir la déclaration d’œuvres à la SOCAN sans le consentement préalable de l’ensemble des ayants droit — appelle une solution simple et juridiquement fondée. Toute déclaration d’œuvre auprès de la SOCAN devrait impérativement être accompagnée d’un contrat d’édition dûment signé par l’ensemble des parties concernées.
Actuellement, la SOCAN permet le dépôt en ligne de titres sans qu’aucune documentation contractuelle ne soit exigée. Cette facilité procédurale constitue une source importante de litiges potentiels, tant à court qu’à long terme. Elle entraîne fréquemment le blocage des droits en raison de conflits de titularité, ce qui, selon toute vraisemblance, engorge le service juridique de demandes et de réclamations (« les fameux claims »).
Je ne saurais affirmer si une telle pratique, manifestement discutable au regard des principes du droit, existe ailleurs dans le monde. Toutefois, je peux témoigner qu’au sein de la SACEM (France) et de la SUISA (Suisse) — deux sociétés de gestion collective dont je connais précisément les procédures — aucune œuvre ne peut être intégrée dans leur répertoire sans la présentation d’un contrat d’édition formel, signé par toutes les parties intéressées.

Situation impossible à la SUISA ou à la SACEM.
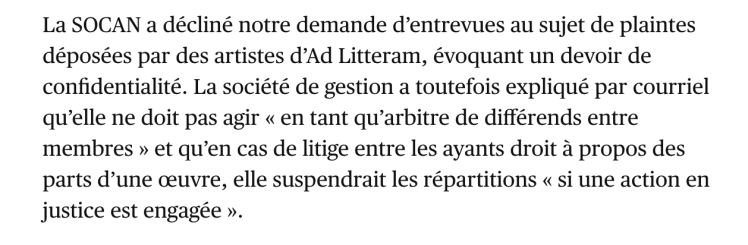
La SOCAN ne serait nullement contrainte de jouer un rôle d’arbitre si elle exigeait, lors du dépôt des œuvres, une documentation contractuelle légalement valable. En présence d’un contrat formel dûment signé par l’ensemble des ayants droit, le litige ne se poserait pas : la situation serait clarifiée dès l’enregistrement des titres, rendant toute contestation ultérieure sans objet.
J’ai porté cette problématique à l’attention du conseil d’administration au sein duquel j’ai siégé pendant cinq années. Cette revendication, pourtant fondée et légitime, a malheureusement été reléguée au rang de simple suggestion, sans qu’aucune suite concrète ne lui ait été donnée.
Donc, s’il y a un désaccord entre ayants droit, la SOCAN met tout sur pause ? Super. Pendant que le label/éditeur/producteur dégaine ses juristes « in house » ou « on call », l’auteur dépouillé d’une partie des revenus de ses droits, lui, doit s’inventer une stratégie de défense avec des moyens de misère. Encore un exemple ou le modèle favorise l’entreprise et non les créateurs.
Alors chers amis créateurs. Y’a plus qu’à devenir entrepreneur !
L’industrie de la musique au Québec c’est… Label First

Participez à la discussion en jouant le jeu 🙂
Questionnaire – En vous lisant, j’ai eu envie de…
Un petit jeu de mon cru : « En vous lisant, j’ai eu envie de… » L’idée est simple : susciter des réactions et des commentaires structurés à la suite de la lecture d’un de mes billets sur Diane Cause Musique.
Pour cela, j’ai imaginé un petit jeu inspiré des célèbres questionnaires de Proust, Pivot ou la reprise de Lipton à une différence près, les réponses peuvent être très courtes (un seul mot) ou très longues.
Le principe : après avoir lu un de mes articles, les « joueurs » se verront remettre un questionnaire composé de 10 questions (toujours les mêmes). Ils pourront ainsi exprimer leur ressenti, leurs réflexions, leurs accords ou désaccords, tout en apportant un éclairage personnel au texte.
Une manière ludique et interactive de prolonger la lecture… et la discussion.
- En vous lisant, j’ai eu envie de…
- Quel passage vous a le plus fait réagir, et pourquoi ?
- Sur quels points êtes-vous totalement en désaccord ?
- Sur quels points êtes-vous pleinement en accord ?
- Une idée, une info, un éclairage nouveau que vous avez découvert ?
- Y a-t-il un angle ou un sujet que vous auriez aimé voir abordé ?
- Depuis la publication, votre regard ou le contexte ont-ils changé ? (1)
- Pourquoi ai-je eu envie de répondre à ce questionnaire ?
- Vais-je changer de trottoir si je croise Diane dans la rue ? (Soyez sincère !)
- Et enfin… un hashtag imaginaire pour cet article ?
(1) Certains billets ont-été écrits il y a longtemps.
Postez vos réponses dans les commentaires